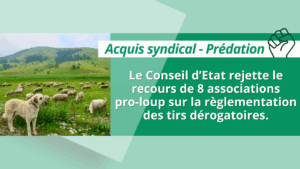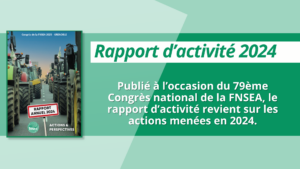Texte adopté au Sénat le 27 janvier 2025, la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur est complémentaire de la Loi d’Orientation Agricole (LOA) adoptée le 25 mars dernier. Quand la LOA donne un cap – celui de la souveraineté alimentaire -, la loi Contraintes pose les conditions d’accès simplifiés aux moyens de production essentiels pour atteindre cet objectif. Elle représente donc un véritable moteur législatif pour l’agriculture.
C’est une loi de responsabilité. Une loi d’équité et de performance. Une loi qui corrige ce qui grippe la machine agricole française :
Ce moteur nous aligne avec nos voisins européens, qui avancent pendant que nous débattons. Il redonne à nos agriculteurs les moyens d’agir, de produire, de transmettre.
 |
Sans cette loi, les ambitions de la France en matière de souveraineté alimentaire, la stabilité alimentaire européenne et notre contribution aux grands équilibres alimentaires mondiaux resteront à l’état d’intention. Sans cette loi, nous reviendront à l’état d’exaspération qui a présidé au lancement des grandes manifestation de l’hiver 2024 ! Arnaud Rousseau, président de la FNSEA |
________________________
24.05.2025 : Prise de parole d’Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, pour dénoncer l’obstruction parlementaire des groupes écologistes et LFI, qui ont déposé près de 2.500 amendements pour empêcher le texte d’aboutir.
23.05.2025 : Communiqué de presse JA/FNSEA | PPL Contraintes : Pour JA et FNSEA, l’obstruction des groupes LFI et Ecologistes méprise les agriculteurs
07.05.2025 : Communiqué de presse JA/FNSEA | PPL Contraintes : Trahison des députés de la Commission du Développement Durable
________________________
Les agriculteurs sont pleinement engagés dans une démarche de progrès continu pour développer des pratiques durables. En 2021, le législateur a rendu obligatoire le Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP), indispensable pour obtenir ou renouveler le Certiphyto qui atteste des bonnes pratiques sur les exploitations.
 Depuis son instauration, le CSP s’est révélé être une obligation réglementaire supplémentaire, et une entrave à la transition des exploitations, plutôt qu’un outil d’aide : lourdeur administrative du dispositif, charge financière trop importante au regard du bénéfice réel, offre de conseil trop limitée liée à la séparation de la vente et du conseil qui interdit aux fabricants de produits sanitaires d’assurer le conseil d’utilisation.
Depuis son instauration, le CSP s’est révélé être une obligation réglementaire supplémentaire, et une entrave à la transition des exploitations, plutôt qu’un outil d’aide : lourdeur administrative du dispositif, charge financière trop importante au regard du bénéfice réel, offre de conseil trop limitée liée à la séparation de la vente et du conseil qui interdit aux fabricants de produits sanitaires d’assurer le conseil d’utilisation.
Dans ce contexte, sur les 235 000 exploitations agricoles concernées, seuls 22 000 CSP pourraient être réalisées annuellement.
C’est un point dur de la mobilisation des agriculteurs à l’hiver 2024. La France perd ses capacités de production pour deux raisons majeures :
A l’heure où la France a posé la souveraineté alimentaire comme axe prioritaire, laisser perdurer ces travers fait courir un risque majeur sur de nombreuses filières.
| La filière noisette en danger La France produit l’équivalent de 12 % de sa demande en noisettes. La demande de noisettes françaises est donc principalement assouvie par les importations, en hausse ces dernières années. Elles s’élèvent à 50 000 tonnes (eq. coque) en 2023, principalement en provenance de Turquie. (Institut Veblen – Etude de cas 2024). En 2024, plus de 50 % de la récolte française de noisettes a été détruite ou non commercialisable, notamment ravagée par le ver de la noisette, le « balanin » et la punaise diabolique (communiqué de la coopérative UNICOQUE / octobre 2024). Les producteurs français ont assisté à la perte sèche de leur production, sans aucun moyen de lutte contre ces ravageurs… Dans le même temps, pour éradiquer le balanin et la punaise diabolique, les producteurs turcs disposent de 15 substances actives insecticides dont 4 sont interdites au sein de l’Union Européenne… (Institut Veblen – Etude de cas 2024) |
Les bâtiments d’élevage sont soumis à la réglementation dite ICPE ( Installations classées pour la protection de l’environnement) , initialement prévue pour l’industrie, et non pour l’agriculture. Cette réglementation contraignante représente une charge financière supplémentaire pour l’exploitant, de l’ordre de 6 000 à 11 600 euros, s’ajoutant aux 20 à 45 000 euros que coûtent aujourd’hui une autorisation.
En effet, l’agriculteur doit prendre en charge le doublement du coût pour le commissaire-enquêteur obligatoire, les charges liées à la location des salles pour les séances publiques et l’accompagnement pendant la phase de consultation, la création et mise à disposition du site internet de consultation du public…
Cette législation complexe constitue un frein majeur au développement des projets d’élevage sur notre territoire. Par exemple, aujourd’hui, en Bretagne, tous les projets sont à l’arrêt, victimes d’un empilement réglementaire inadapté aux réalités du terrain.
Face aux risques climatiques, de plus en plus nombreux et violents, les agriculteurs disposent d’une assurance récolte rénovée. Après deux années d’exercice, certains ajustements sont nécessaires pour que le dispositif reste efficace et adapté au plus grand nombre.
C’est le cas notamment pour les exploitations d’élevage, qui ont besoin d’avoir des voies de recours en cas de litige plus simples, plus fiables et plus efficaces.
Il n’y a et il n’y aura pas d’agriculture sans eau, et il est indispensable de poser dès maintenant les modalités d’un accès sécurisé et équitable à l’eau.
Cela concerne la préservation de l’accès à l’eau aux fins d’abreuvement du bétail notamment dans un contexte climatique qui voit les épisodes de sécheresse s’accélérer et s’accentuer.
Cela concerne également la facilitation, sous conditions, des ouvrages de stockage et les prélèvements dans les zones déficitaires.
Il est également fait état dans cette proposition de loi d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides. Il s’agit de prendre en compte la réalité du terrain en allégeant les contraintes pesant sur les zones classées « humides » mais qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions écologiques liées à cette classification.
Si la suradministration et la pression administrative sclérosent l’activité agricole et pèsent sur les trésoreries des exploitations, leur compétitivité et le moral des agriculteurs, les agriculteurs souhaitent entretenir avec les instances de contrôle et d’accompagnement une relation apaisée et constructive.
C’est d’une importance capitale pour continuer à progresser, mais pour cela, un cadre respectueux et proportionné doit être posé.
Certaines critiques et caricatures ont présenté cette loi comme une tentative de revenir sur des avancées environnementales, en particulier en ce qui concerne l’interdiction des néonicotinoïdes, souvent associés au déclin des populations d’abeilles. D’autres ont souligné le risque d’une déréglementation au profit des intérêts économiques, au détriment de la santé publique et de l’environnement.
Il est important de rappeler que cette loi ne propose pas une réautorisation générale des néonicotinoïdes, mais envisage la possibilité de leur usage dans des conditions spécifiques sur certaines productions. Et de rappeler aussi que leur usage est autorisé après avis de l’EFSA (autorité européenne de sécurité des aliments) et que nos voisins européens les utilisent.
Sur l’ANSES, affirmer que la délivrance des autorisations de mise sur le marché sera pilotée par des choix politiques relève de la contrevérité. Il s’agit en réalité d’organiser une concertation avec les agriculteurs confrontés à des impasses de traitement pour proposer, à l’ANSES, une priorisation de ses travaux. L’autorisation de mise sur le marché restant basée sur des éléments scientifiques.
Il est a noté que tous les moyens sont utilisés pour tromper l’opinion publique sur cette loi avec certains sondages totalement biaisés qui laissent à penser qu’une grande majorité des Français sont opposés à cette loi ? Ceci est totalement faux et biaisé puisqu’une grande majorité des Français déclarent ne pas avoir suffisamment de connaissance de cette loi pour s’exprimer.
|
|
La FNSEA est un membre actif et engagé au sein de l’Association Contrat de solutions, pour identifier et déployer largement les solutions alternatives identifiées collectivement comme durables, efficaces et économiquement viables pour la protection de toutes les cultures et sur l’ensemble du territoire français. Cette initiative proactive du monde agricole doit être reconnue, encouragée et soutenue dans la durée pour se traduire pleinement sur le terrain. Pas d’interdiction sans solutions. |
.
_____________________________________
Liens utiles :